Guide pour lanceurs d’alerte
Nous rejoindre c’est soutenir la lutte contre la corruption
…étapes à suivre, conseils de protection, premiers réflexes à avoir.
Qui peut lancer une alerte
Seule une personne physique (pas une association ou une entreprise) peut être lanceur d’alerte. Il faut agir de bonne foi, sans intention de nuire ni contrepartie financière, et détenir des éléments concrets sur les faits à signaler (documents, emails, témoignages).
Qu’est-ce qu’une alerte ?
Une alerte porte sur un acte illégal, une fraude, une atteinte à l’intérêt général ou une menace grave pour la sécurité publique, la santé, l’environnement ou les finances publiques. De simples dysfonctionnements ne suffisent pas : il faut que le signalement repose sur des preuves ou éléments sérieux.
Comment préparer son signalement ?
-
Rassembler tous les éléments et preuves : faits précis, dates, documents, témoignages.
-
Rédiger un récit clair et chronologique.
-
Préciser le contexte, les personnes impliquées et ce qui est en jeu.
Qu'est ce qu'un lanceur d'alerte ?
Un lanceur d’alerte est toute personne, groupe ou institution qui adresse un signal d’alarme en espérant enclencher un processus de régulation ou de mobilisation collective, après avoir eu connaissance d’un danger, d’un risque ou d’un scandale avéré.
À la différence du délateur, le lanceur d’alerte estime agir pour le bien commun ou l’intérêt général, animé de bonnes intentions, généralement de manière bénévole et désintéressée, souvent contre l’avis de sa hiérarchie. Son but est d’informer les instances officielles, associations et le journalisme d’enquête.
En France, la notion est apparue en 1999 dans un livre des sociologues Francis Chateauraynaud et Didier Torny, à propos d’alertes sanitaires et environnementales, et une Maison des lanceurs d’alerte a été fondée en 2018 par 17 associations et syndicats car depuis la fin des années 1990, des lanceurs d’alertes sont menacés ou poursuivis. La protection des sources d’information du journalisme d’enquête est une règle de droit et un principe de la déontologie du journalisme, pilier de la Charte de Munich, qui date elle de 1971.
Des mouvements associatifs ou politiques veulent une législation les protégeant, comme aux États-Unis et au Canada, des risques encourus : licenciement, assassinat, atteintes à la santé ou à la tranquillité de sa famille, procédures-bâillons en justice visant à censurer et ruiner. Selon le professeur de sciences de gestion Bertrand Venard, « mieux protéger les lanceurs d’alerte, c’est aussi sécuriser l’économie » car la corruption freine son développement, par « de mauvaises décisions, un surcoût des achats et une diminution des investissements ».
En France, le Grenelle de l’environnement prend position en 2007 pour leur protection juridique et la loi Sapin II instaure en 2016 un statut de lanceur d’alerte, incluant la protection contre toute forme de représailles. Une directive de l’Union européenne est ensuite adoptée en 2019 pour protéger « les personnes signalant des violations du droit de l’Union ».

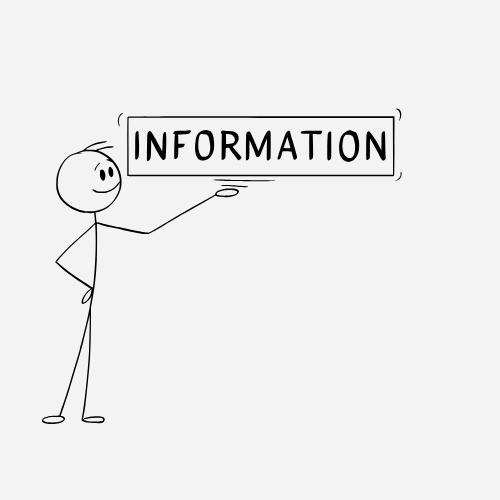

Où et comment signaler ?
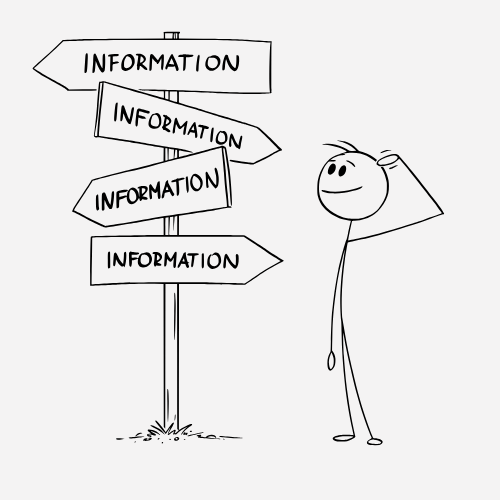
Signalement interne : adressez votre alerte à la hiérarchie, l’employeur ou au référent « alerte éthique » (s’il existe).
Signalement externe : contactez une autorité compétente : Défenseur des droits, administration spécialisée, ou organisme officiel selon la nature des fait
Rendre public l’alerte : possible en dernier recours si les signalements internes et externes n’ont pas abouti, ou en cas de danger grave et imminent.
Peut on rester anonyme?
Le lanceur d’alerte doit en principe être identifiable, mais l’anonymat est possible et parfois recommandé pour les cas graves. Attention : la gravité des faits doit être clairement établie et les preuves solides
